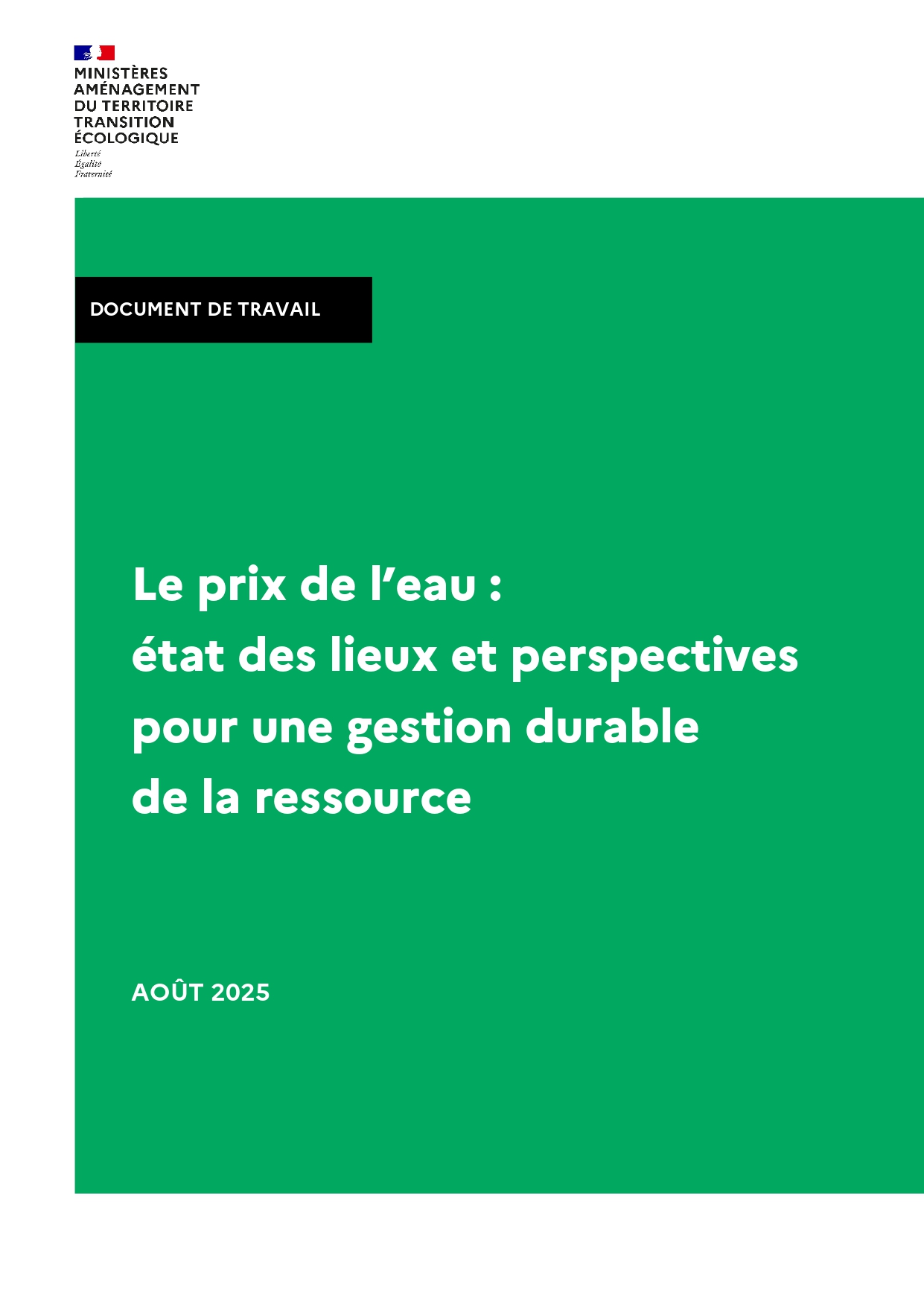La disponibilité d’une eau de qualité offre de nombreux bénéfices, mais son usage implique des coûts économiques et environnementaux. Pour les recouvrir, le tarif, les subventions et les redevances ou taxes environnementales sont utilisés. Le prix de l'eau constitue, dans le financement, la part directement payée par les usagers. Outre sa fonction de financement, son utilisation en tant qu’instrument pour inciter à économiser l'eau pose des questions d'acceptabilité sociale.
En France, le prix de l'eau potable assainie inclut le tarif de fourniture du service, des redevances environnementales et des taxes. En 2024, il atteint 4,69 €/m³ (soit 563 €/an pour un ménage consommant 120 m3), mais les recettes générées sont insuffisantes pour financer les investissements nécessaires au renouvellement des infrastructures : il manque entre 0,3 à 4,8 Md€/an). Outre la couverture des coûts de production du service, la législation a progressivement encouragé une facturation intégrant des enjeux environnementaux puis sociaux. L'élasticité-prix de la demande d'eau potable varie entre - 0,1 et - 0,6 : une hausse de prix de 10 % réduit la consommation de 1 à 6 %.
Mieux informer et accompagner les consommateurs s’avère nécessaire pour qu’ils puissent adapter leur consommation face aux hausses de prix. S’agissant du volet social, selon la littérature, les dispositifs d'aide en dehors de la facture pourraient être plus efficaces pour assurer l'accès à l'eau des ménages
à faible revenu que la tarification progressive. Le secteur de l’agriculture est le principal consommateur d'eau dans de nombreuses régions, mais les données sur le prix de l'eau pour l'irrigation sont limitées. En 2015, le tarif moyen de l'eau dans les réseaux collectifs d'irrigation sous pression était estimé à 0,15 €/m³, ne couvrant que partiellement les coûts d’investissement. S’y ajoute une redevance pour prélèvement dont le niveau (de 0,85 à 2,57 centimes €/m³ selon les bassins) est insuffisant pour inciter à économiser l'eau.